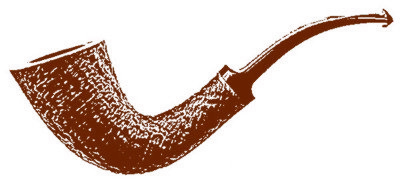Il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de se représenter — à près de cinq siècles de distance — l’impact que produisit la découverte des Amériques sur la conscience européenne. On pourrait penser qu’à bien des égards seule une rencontre avec une civilisation extraterrestre constituerait un"choc des civilisations"comparable. Sans doute l’indifférence a-t-elle sagement prévalu : après 1492, bien des gens sont nés, ont vécu et sont morts sans savoir que l’Amérique existait et qu’elle avait été découverte. Et même s’ils l’ont su, cette information n’a affecté ni leur vie quotidienne, ni leur vision du monde, pas plus que nos propres existences ne se trouvent modifiées à l’annonce de la découverte d’une planète lointaine, fût-elle exactement semblable à la nôtre.
Du Nouveau Monde, les navigateurs européens ont rapporté pêle-mêle, de l’or, des maladies vénériennes (la syphilis était inconnue en Europe) et des produits alimentaires ou agricoles nouveaux : entre autres, le maïs, les haricots, la pomme de terre, la tomate et le tabac. Les quatre premiers sont entrés dans nos vies et font l’objet de la plus large approbation. Il n’y a jamais de campagne, dans la presse écrite ou audiovisuelle, contre les haricots. Quand on parle du maïs, c’est pour s’inquiéter du destin de ses variétés génétiquement modifiées ; lorsqu’on évoque la tomate, c’est pour déplorer son manque de saveur. Quant à la pomme de terre, le plus humble des produits de la terre, on oublie généralement qu’on lui doit d’avoir fait disparaître la famine en Europe.
Il n’en va pas de même pour le cinquième de ces produits, le tabac. Des campagnes anti-tabac sont menées régulièrement et le moindre paquet de cigarettes s’orne de mises en garde dont la typographie imite habilement les faire-part de décès. Rien à voir avec la parfaite innocence, la parfaite innocuité, de la tomate ou de la pomme de terre. Notre société est très nettement polarisée entre fumeurs et non fumeurs, et cette dualité ne s’exprime pas toujours sans agressivité. Les non-fumeurs ont leurs raisons d’éviter le tabac et les fumeurs ont les leurs pour pratiquer la tabagie. Un fumeur donnera toutes sortes de justifications : le tabac apporte une détente, coupe la faim, favorise la concentration, libère l’esprit, etc. Mais à aucun moment, il faut le noter pour commencer, on n’entendra un fumeur régulier ou occasionnel dire :"Je fume parce que c’est bon pour la santé !". Il est évident pour nous que le tabac est dangereux. Or, si nous remontons le cours du Temps, en nous rapprochant de l’origine de la découverte de cette plante, nous nous apercevrons qu’il n’en fut pas toujours ainsi. Entre la Renaissance et nos jours, le discours littéraire ou médical sur ce produit s’est radicalement transformé. Ce sont les conditions, les circonstances de ce renversement, que nous allons examiner.
Tous ceux qui ont lu le Don Juan de Molière savent qu’il s’ouvre sur une didascalie et une tirade plutôt surprenantes, dont on comprend mal ce qu’elles font là :"SGANARELLE, tenant une tabatière. — Quoi que puisse dire Aristote et toute la Philosophie, il n’est rien d’égal au tabac : c’est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n’est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l’on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu’on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d’en donner à droite et à gauche, partout où l’on se trouve ? On n’attend pas même qu’on en demande, et l’on court au-devant du souhait des gens : tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d’honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c’est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours". Éloge burlesque, paradoxal, pour au moins une raison : Aristote n’a jamais pu penser quoi que ce soit du tabac, introduit en Europe deux millénaires après sa mort. Ce panégyrique est une parodie de la rhétorique employée sur les foires par les bonimenteurs, les marchands d’orviétan et de plantes bienfaisantes. Mais il s’agit également d’un éloge du don, de la vie sociale, de la convivialité et de l’attention aux désirs des autres. On trouve d’autres éloges burlesques dans Don Juan : l’inconstance, la couardise, le blasphème, l’émétique, le Moine bourru, … Molière écrivait des comédies, il se devait de faire rire, ou au moins sourire son public. Sganarelle est un personnage ridicule, que sa tirade doit montrer comme tel. Or, qu’y a-t-il de vraiment drôle dans ce passage ? Si l’on s’avisait aujourd’hui de l’insérer dans un film, non seulement un tel éloge ne ferait rire personne, mais encore il susciterait un tollé. Il faut donc retrouver des textes antérieurs à Don Juan (1665), pour essayer de comprendre cette page, non sans avoir rappelé que, sous l’Ancien Régime, on ne consommait pas tout à fait le tabac comme aujourd’hui : la cigarette n’existait pas (c’est une invention du XIXe siècle industriel) ; on se servait principalement de pipes en terre, ou on le buvait sous forme d’infusion, de tisane, sans oublier deux autres façons qui ont à peu près disparu aujourd’hui : la chique et la prise.
Il n’est pas inutile de rappeler également que Christophe Colomb et ses équipages prirent contact avec le tabac dès leur arrivée aux Bahamas et à Cuba. Quelques jours après avoir débarqué, Colomb vit passer des autochtones transportant de grandes feuilles d’une plante inconnue, à laquelle ils semblaient beaucoup tenir. Bartolomé de Las Casas, le célèbre défenseur des Indiens, qui était de ce voyage, observa que les indigènes fumaient des sortes de rouleaux, ancêtres lointains des cigares. Un autre compagnon de Colomb, Rodrigo de Jerez, fit mieux qu’observer : il fuma, y prit goût et se constitua un stock personnel de tabac, pour le ramener en Espagne. De retour à Barcelone, en 1498, il eut la mauvaise idée de fumer dans la rue. C’était la première fois en Europe qu’on voyait quelqu’un fumer du tabac et ce fut la stupeur. On le dénonça aux autorités religieuses, en affirmant qu’il était possédé du démon, puisque, comme le Diable lui-même, il exhalait de la fumée par la bouche et le nez. L’Inquisition l’arrêta, le jugea et le jeta en prison pour dix ans. Telles furent les débuts, plutôt malheureux, du tabac en Europe. Mais le succès allait venir.
L’introduction de la plante en France fut plus tardive et personne, semble-t-il, n’alla au cachot à cause d’elle. André Thevet, un moine navigateur, rapporta des graines de son voyage au Brésil et les fit pousser à partir de 1556 dans son jardin d’Angoulême, d’où le premier nom français du tabac, l’angoulmoisine. La découverte de Thevet fut usurpée par l’ambassadeur de France au Portugal, Jean Nicot, qui passa à la postérité et, d’une certaine manière, se trouva puni de son usurpation en voyant son nom définitivement attaché à la plante et à l’alcaloïde qu’elle contient. Au Portugal, Nicot avait découvert qu’on utilisait le tabac en cataplasme, pour remédier aux troubles cutanés, et en prise, pour soigner les infections du nez et des voies respiratoires. Il en fit envoyer des échantillons à Paris, car il savait que Catherine de Médicis souffrait de fortes migraines, que personne ne parvenait à apaiser. La reine prisa du tabac et se trouva soulagée. Dans une société aussi verticale que la France d’Ancien Régime, où les modes partaient du haut de l’État pour se diffuser vers le reste de la société, l’exemple de Catherine ne tarda pas à faire école. Le tabac était une denrée rare, mais les médecins en firent une sorte de panacée, soignant la peau, la tête et prévenant la peste (on l’utilisa ainsi en 1637, durant l’épidémie qui sévit à Nimègue)1. On donnait au tabac les noms d’herbe à la Reine, d’herbe médicée, d’herba Catharina, voire, ce qui indiquait assez la confiance qu’on avait en ses vertus, d’herba panacea. On en prisait, on en fumait, on en buvait en décoction, on en mâchait les feuilles et surtout — chose inimaginable aujourd’hui — les médecins en recommandaient chaleureusement l’usage. Le tabac soignait le rhume, les maux de dents, l’asthme, les ulcères, la dysménorrhée, la variole, le scorbut, … Depuis longtemps déjà, les bureaux de tabac sont signalés par une"carotte", souvenir du temps où les débitants recevaient leur marchandise pressée sous forme de grands rouleaux coniques et en râpaient au client la quantité désirée. On sera peut-être surpris d’apprendre qu’avant d’être celui des buralistes, la carotte fut l’emblème des pharmaciens, des apothicaires, qui commercialisaient le tabac. Plus tard, ces derniers adoptèrent le caducée et la carotte demeura au seul usage des débitants de tabac.
De l’autre côté de la Manche, l’herbe à Nicot connut une vogue semblable. Au début du XVIIe siècle, voici ce qu’on pouvait voir dans les villes anglaises :"Lorsque les enfants partaient à l’école, ils emportaient dans leur cartable une pipe que leur mère avait pris soin de bourrer tôt le matin et qui leur servait de petit déjeuner. À l’heure habituelle, tous posaient leur livre pour remplir de nouveau leur pipe, le maître fumant avec eux et leur apprenant comment tenir leur pipe et à la bien remplir, les habituant à fumer dès leur tendre jeunesse, convaincus qu’ils sont de la nécessité absolue du tabac pour conserver une bonne santé". Passant à Londres en octobre 1599, le voyageur bâlois Thomas II Platter (1574-1628) a consigné cette description pittoresque :"Dans les tavernes à bière, on peut se procurer aussi du tabac alias herbe vulnéraire païenne. Le tavernier vous en donne chaque fois pour un pfennig. On l’allume dans un petit tube, on aspire ou suce la fumée dans la bouche, et de cette même bouche on laisse couler le plus de salive possible. Après quoi on boit un bon coup, Trunck, d’excellent vin d’Espagne. On utilise aussi le tabac comme médecine spéciale pour le rhume de cerveau. En même temps, c’est pour le plaisir. Tellement commun en Angleterre est le tabac qu’ils ont toujours leur bouffarde sur eux à portée de main ; ils la promènent en tous lieux, dans les théâtres, les auberges ; ils battent le briquet, allument la pipe, et boivent. C’est comme chez nous quand on apporte du vin. Ça les excite furieusement, ça les rend gais ; au point que la tête leur tourne, comme s’ils s’étaient saoulés. Mais bientôt le malaise se dissipe. Et ils abusent tellement de ce tabac, en vue du plaisir que ça leur donne, que les prédicateurs poussent des hurlements : “Fumeurs, vous courez à votre perte !”2. On m’a même raconté qu’on avait disséqué les veines d’un homme atteint de tabagie. Elles étaient revêtues de suie à l’intérieur, comme le dedans d’une cheminée !". Une autre histoire courait à travers l’Europe, celle d’un gros fumeur qui avait été autopsié après sa mort : son cerveau, racontait-on, se présentait sous la forme d’une épaisse masse de cendre de tabac… Toutefois, le tabac avait rencontré en Angleterre un ennemi d’importance, le Roi en personne, Jacques Ier, le fils de Marie Stuart, qui publia anonymement en 1604, un Coup de trompette contre le tabac (Counterblast to Tobacco), opuscule contenant des passages que l’on pourrait réimprimer tels que :"Comment le cerveau, qui est humide, pourrait-il supporter l’inhalation d’une fumée sèche et chaude ? La fumée introduit dans tout l’organisme de la suie qui l’encrasse. L’habitude de fumer est malpropre, malodorante, coûteuse, et crée une accoutumance périlleuse, une ivresse comparable à celle du vin". La mode du tabac, ajoute-t-il, est"dégoûtante à la vue, repoussante à l’odorat, dangereuse pour le cerveau, malfaisante pour la poitrine, qui répand des exhalaisons aussi infectes que si elles sortaient des antres infernaux". Mais les reproches procèdent au fond moins de l’hygiène que de la morale : pas question de laisser les Anglais s’avilir au rang des Indiens :"Si les Indiens fument le tabac, c’est pour se soigner de la syphilis ; pourquoi nous autres, Anglais, imiterions-nous ces peuplades païennes, au risque de paraître avoir la même maladie qu’elles ?"3. Il n’est pas impossible que le tabac ait joué un rôle dans l’aversion que Jacques Ier entretenait à l’encontre de Walter Raleigh, ancien courtisan de la reine Elizabeth. Celui-ci avait fondé en Amérique du Nord une colonie appelée Virginie, en hommage à celle qu’on surnommait"la reine vierge"(elle n’avait pas eu d’enfants). Il y cultiva du tabac (et on en cultive du reste toujours). Enfermé à la Tour de Londres entre 1603 et 1616, à la suite d’un vague complot, Raleigh obtint de prendre le commandement d’une nouvelle expédition transatlantique. Du côté de l’Orénoque, il provoqua un incident diplomatique avec l’Espagne. Jacques Ier ne le lui pardonna pas : de retour au pays, Raleigh fut condamné à mort et exécuté en 1618. Ultime bravade à l’égard du monarque anti-tabac : Raleigh monta à l’échafaud en fumant sa pipe (qui a été recueillie à la manière d’une relique et qui fait partie des collections de la maison Dunhill, à Londres).
Incapable, malgré tous ses efforts, d’enrayer la vogue de la tabagie, Jacques Ier se consola comme se consolent tous les gouvernements en pareille circonstance : il frappa l’importation du tabac de lourdes taxes. Autant en fit Richelieu en France. Contemporain de Jacques Ier d’Angleterre et du cardinal-ministre, le pape Urbain VIII (surtout connu pour avoir fait condamner Galilée) interdit à tout le monde, et particulièrement aux prêtres, sous peine d’excommunication ipso facto, de fumer dans les églises du diocèse de Séville (bulle du 30 janvier 1641). La mesure ne semble guère avoir eu d’effet dissuasif et elle sera levée par Clément XI en 1700. On peut raisonnablement supposer que, si la bulle d’Urbain VIII n’avait pas été abrogée par Clément XI, elle l’aurait de toute manière été par Benoît XIII, lui-même grand amateur de tabac à priser. La question fut réglée définitivement en 1779, lorsque la papauté fit ouvrir à Rome une manufacture de tabac, mettant ainsi fin à un siècle et demi de rapports compliqués et conflictuels entre l’Église et l’herbe à Nicot4.
La mode du tabac s’était répandue à une vitesse foudroyante, mais on se montrait plus sévère vis-à-vis des fumeurs dans certains pays que dans d’autres. Dès 1605 (soit un an après le traité de Jacques Ier d’Angleterre contre le tabac), le sultan de l’empire ottoman interdit à tous ses sujets de fumer. Les contrevenants s’exposaient à une promenade infamante dans les rues de la ville, à dos d’âne, et, en cas de récidive, à la peine de mort. La Perse semble s’être montrée libérale, d’après le témoignage d’un voyageur allemand :"Il n’y a presque point de Persan de quelque condition ou qualité qu’il puisse être, qui ne prenne du tabac en fumée, en quelque lieu qu’il se trouve, même dans leurs Mosquées, tant ils en sont amateurs et en font leurs délices". En revanche, ce même voyageur écrit à propos de la Russie :"Le tabac étoit autrefois si commun en Moscovie, que l’on en voyoit prendre par-tout, en fumée, ou en poudre. Pour remedier à cet abus et pour éviter les désordres et les malheurs qui en naissoient, non seulement parce que les pauvres gens se ruinoient, en ce que dès qu’ils avoient un sol, ils l’employoient en tabac plutôt qu’en pain, mais aussi parce qu’ils mettoient souvent le feu aux maisons, et se présentoient avec l’haleine puante et infecte devant leurs images, le Grand-Duc et le Patriarche jugèrent à propos l’an 1634. d’en défendre absolument la vente et l’usage"5. Il semble en effet qu’au moins un des incendies qui endommagea Moscou était parti d’une pipe mal éteinte ou mal allumée. De fait, les peines prévues étaient sévères, puisque les fumeurs russes risquaient l’amputation du nez. Pour finir ce petit tour du monde en revenant au point de départ, il semble qu’en Espagne, contrairement à la France ou à l’Angleterre, l’usage du tabac n’ait jamais atteint les hautes sphères de la société. Les marins, les hommes de peine fumaient, mais l’exemple de Jerez, jeté en prison par l’Inquisition, dut en faire réfléchir plus d’un. L’irremplaçable humour irlandais, quant à lui, produisit ce proverbe :"Dieu créa d’abord l’homme, puis la femme. Ensuite l’homme Lui fit pitié et Il créa pour lui le tabac"; relayé par George Bernard Shaw :"Qui garde le silence alors qu’il a tort est un sage. Qui garde le silence alors qu’il a raison est un homme marié ou un fumeur de pipe".
Le continent européen était donc enfumé de l’Atlantique à l’Oural. En France, toute la société s’était prise de passion pour le tabac, à tel point que Madame de Sévigné en usera pour une comparaison :"C’est une folie comme du tabac ; quand on y est accoutumée, on ne peut plus s’en passer"6. Seule exception — de taille : Louis XIV, qui n’en supportait pas l’odeur et interdisait de fumer dans ses appartements ou, à plus forte raison, en sa présence. Le duc de Saint-Simon fumait la pipe et cela ne l’aida sans doute pas à retrouver la faveur du monarque7. Mais, si le Roi-Soleil détestait le tabac (comme plus tard Napoléon), il faisait en sorte que ses soldats en eussent toujours à disposition. Une gravure d’Abraham Bosse représente deux officiers attablés sans façons dans une chambre, fumant de longues pipes en terre. Elle s’accompagne de ce quatrain :"Quand nous sommes remplis d’humeur melancolique / La vapeur du Tabac ravive noz espris, / Lors de nouvelle ardeur entierement surpris, / Nous veincrions le Dieu Mars en sa fureur bellique". Il n’y avait aucune raison pour que les écrivains ne s’emparent pas du sujet. En Angleterre, John Beaumont publia en 1602 La Métamorphose du tabac, un poème inspiré d’Ovide, où il raconte la création du tabac par les dieux, afin de soulager l’espèce humaine. Dans un autre texte publié la même année, un autre Anglais, Joshuah Sylvester, nettement plus critique, plaça sur le même plan l’or, l’artillerie et l’herbe à Nicot, les trois plus grands fléaux du genre humain. Une comédie anglaise du début du XVIIe siècle, Monsieur d’Olive de George Chapman, se moque de la condamnation du tabac par les Puritains (ceux dont Jacques Ier se débarrassera en les envoyant coloniser l’Amérique du Nord à bord du Mayflower) et contient un éloge de la plante, très ambigu, qui n’est pas loin de ressembler à celui qu’on lira chez Molière :"Le tabac, cette excellente plante, dont le monde ne peut se passer, est un abrégé de la Nature, où toute son ingéniosité se trouve résumée, où l'on voit la terre unie au feu, le feu pousser une exhalaison qui, entrée par la bouche, parcourt les régions du cerveau humain, en faire sortir toutes les mauvaises vapeurs, sauf elle-même. Les mauvaises humeurs, qui pourraient (si elles ne l’ont déjà fait) former une croûte autour du cerveau tout entier, ressortent par la bouche. Une plante d’un usage singulier : car, d’un côté, la Nature a horreur du vide, alors que de l’autre, il y a dans le monde tant de crânes vides. Comment la Nature pourrait-elle continuer sa marche ? Comment ces crânes vides pourraient-ils être remplis avec autre chose que de l’air, que la Nature utilise à cette fin ? S’il faut qu’ils soient remplis d’air, quoi de plus approprié que le tabac ?"8.
En France, le tabac fait l’objet de compositions poétiques légères, comme cette brève apologie due à un poète grenoblois, le sieur de La Garenne :"N’as-tu jamais resvé le coude sur la table, / Et la pipe à la main ? / Tout ce que nous pensons nous semble indubitable / Cet appas delectable / Nous empesche d’avoir soucy du lendemain"9. Plus fameux, le sonnet de Saint-Amant10 :"Assis sur un fagot, une pipe à la main, / Tristement accoudé contre une cheminée / Les yeux fixes vers terre, et l’ame mutinée, / Je songe aux cruautez de mon sort inhumain. // L’espoir qui me remet du jour au lendemain, / Essaye à gaigner temps sur ma peine obstinée / En me venant promettre une autre destinée, / Me fait monter plus haut qu’un Empereur romain. // Mais à peine cette herbe est-elle mise en cendre, / Qu’en mon premier estat il me convient descendre, / Et passe mes ennuis à redire souvent. // Non je ne trouve point beaucoup de difference / De prendre du tabac, à vivre d’esperance, / Car l’un n’est que fumée, et l’autre n’est que vent".
On a gardé pour la fin le moins connu : le long poème latin composé par le père jésuite Jacob Balde, (1604-1668), né en Alsace (à Ensisheim), qui mena toute sa carrière ecclésiastique en Bavière. Ce fut un très grand poète latin, en même temps qu’un personnage parfois étrange, proche à certains égards des Puritains anglais dans sa condamnation de la chair. Balde avait fondé à Munich une très curieuse Congregatio macilentorum, une sorte de cercle composé uniquement de gens maigres et qui s’engageaient à tout faire pour le rester. En 1657, il donna un long poème latin intitulé Satyra contra abusum Tabaci, où il s’attardait à la description des pipes à tabac, au cadre de vie des fumeurs et aux diverses manifestations de leur folie, car à ses yeux c’est bien de folie, de manie, qu’il s’agit. Balde énumère les conséquences de la tabagie : le tabac rend les gens fous, cause leur ruine, brise les ménages. Il insiste sur les terribles effets de la fumée sur les femmes (en particulier lorsqu’elles ont de jeunes enfants)11.
Aucun médecin, aucun professionnel de la santé, ne risquerait aujourd’hui sa réputation à prétendre que le tabac possède des vertus médicinales ou thérapeutiques. Pourtant, des décennies, voire des siècles durant, l’herbe à Nicot fut consommée comme un médicament par nos ancêtres, en France et ailleurs, ce qui nous paraît le comble de l’aberration. Cet usage du tabac à des fins curatives ne signifie pas qu’on n’ait jamais vu se lever aucun opposant, bien au contraire, et certains des textes cités précédemment pourraient être repris sans grandes modifications dans nos campagnes anti-tabac. Mais il faut constater une différence profonde : les critiques que l’on formulait jadis vis-à-vis du tabac étaient au fond moins d’ordre médical que d’ordre moral. On reprochait aux fumeurs leur nonchalance, leur penchant à la rêverie et à l’oisiveté, qui s’opposaient aux valeurs du travail, sur lesquelles reposait la société d’Ancien Régime. Nous ne reprochons plus au tabac d’empêcher les gens de travailler et, de toute manière, nous vivons dans une société où le travail n’est plus une valeur dominante. À l’âge baroque, la morale était d’essence religieuse et, comme aucun interdit religieux ne visait directement le tabac, on rattacha sa consommation à des vices déjà mis en évidence et condamnés, tels l’ivrognerie ou la paresse. Les changements survenus dans notre perception du tabac révèlent des enjeux plus profonds : dans la société actuelle, puisqu’il n’y a plus de morale à laquelle chacun puisse et doive se référer, mais, à sa place, un ensemble mouvant d’attitudes individuelles ou communautaires, la critique du tabac a glissé de l’éthique à la médecine, parce que celle-ci propose un discours cohérent et dont les prescriptions s’imposent à tous (nonobstant des prises de position comme"mon corps m’appartient", qu’on n’entend d’ailleurs rarement dans les discussions sur la tabagie). Nous vivons dans un univers relativiste, où il n’est plus possible de porter un jugement moral en fonction d’absolus tels que le bien ou le mal ; un univers dans lequel le fait de porter un jugement d’ordre moral sur une situation donnée est perçu comme une manière de s’ériger en juge de la personne qui vit cette situation, et cela nous semble intolérable. Le champ laissé libre par la morale a été occupé de façon naturelle, en l’occurrence par la médecine, qui juge désormais de ce qui est bon ou mauvais, en fonction de sa norme absolue : la prolongation indéfinie de la vie humaine. Molière, à qui il faut revenir, avait mis en scène un personnage chez qui la morale et la religion ont été remplacées par la médecine. Il semble qu’aujourd’hui la société entière ressemble à la maison du Malade imaginaire. C’est à présent la médecine, et non plus la morale, qui détermine les normes du bien et du mal. On notera pour finir, et cela incitera à l’optimisme ou au pessimisme, que les campagnes menées contre cette pratique importée d’Amérique par les Européens n’ont guère plus de résultats que les attaques de Jacques Ier d’Angleterre, voire la répression musclée des tsars de Russie. Faut-il donc que ceux qui critiquent le tabac soient convaincus du bien-fondé de leur cause, pour déployer en vain tant d’énergie, et faut-il aussi que les fumeurs y prennent du plaisir, pour résister depuis cinq siècles à tant de déploiement persuasif et de restrictions diverses !
* Cet article donne à lire le texte d’une conférence prononcée à Saint-Dié le 30 septembre 2006, dans le cadre du Festival International de Géographie. Je remercie la Société Philomatique Vosgienne et son président, M. Jean-Claude Fombaron, de m’avoir donné la possibilité de mettre en forme ce dossier. Souhaitant lui conserver autant que possible son caractère initial, j’ai réduit à l’essentiel les notes. De nombreux faits appartiennent à l’histoire et se trouvent dans la plupart des bons livres consacrés à la tabagie, qui tous contiennent au moins un chapitre sur l’introduction du tabac en Europe. J’ai seulement donné les références des textes les moins connus. Bien entendu, ce travail ne prétend pas à l’exhaustivité : bien des textes, comme le Traité du tabac de Jean Neander (1625), mériteraient une étude spéciale.
1 Dr. Peigney,"Journal d’un médecin pendant la peste de Nimègue en 1637", La Chronique médicale, XXXVIII, n° 3, 1er mars 1931, p. 63-64.
2 L’Europe de Thomas Platter : France, Angleterre, Pays-Bas (1599-1600), trad. Emmanuel Le Roy Ladurie et Francine-Dominique Lichtenhan, Paris, Fayard (= Le Siècle des Platter, t. III), 2006, p. 368.
3 Michel Duchein, Jacques Ier Stuart, P., Fayard, 2003, p. 325.
4 Dans un recueil classique, les Conférences ecclésiastiques du diocèse d’Angers, on lit le passage suivant :"Il y a des docteurs qui disent qu’il n’est pas permis de prendre du tabac avant que de dire la Messe ou de communier, tant parce qu’il y a lieu de craindre qu’en prenant du tabac on ne rompe le jeûne naturel, que parce qu’il y a en cela une grande indécence et un manque de respect pour l’Eucharistie. Il faut distinguer entre prendre du tabac par le nez, et entre mâcher du tabac en feuilles, ou le prendre en fumée. Nous estimons que le tabac en poudre ou en feuilles qu’on prend par le nez ne rompt point le jeûne naturel, car il ne descend pas dans l’estomach, et il ne paroît pas y avoir de l’indécence ou de l’irrévérence à en prendre avant que de célébrer la Messe, ou de communier ; il est donc permis de célébrer et de communier après en avoir pris.
"Quant au tabac qu’on prend par la bouche en mâchicatoire ou en fumée, nous croyons […] que quand on en avale quelque peu de suc ou de la fumée, le jeûne naturel est rompu. Ainsi on doit s’abstenir ce jour-là de célébrer la Messe et de communier. Quand même il seroit vrai […] que le jeûne naturel ne seroit pas rompu, si par hasard on avoit avalé un peu du suc du tabac avec la salive, ou un peu de fumée, ou si l’on n’avoit point avalé du tout ni suc ni fumée, il y a toujours de l’indécence et de l’irrévérence à mâcher du tabac et en prendre en fumée avant que de célébrer ou de communier ; c’est pourquoi on doit conseiller de s’en abstenir avant que d’approcher de l’Autel ou de la Sainte Table. Aussi le troisieme Concile de Lima et le troisieme de Mexico, ont fait défenses aux Prêtres de prendre par la bouche, en quelque maniere que ce soit, du tabac avant que de célébrer la Messe"(François Babin, Sur l’Eucharistie et le sacrifice de la messe, Paris, Gueffier, 1778, p. 209-210).
5 Voyages très-curieux et très-renommez faits en Moscovie, Tartarie et Perse, par le sieur Adam Olearius, bibliothécaire du Duc de Holstein, et Mathematicien de sa cour, trad. Wicquefort, Amsterdam, Michel Charles Le Cene, 1727, t. II, p. 831-832 et t. I, p. 218.
6 Lettre du 16 octobre 1675 ; édition de la"Bibliothèque de la Pléiade"par Roger Duchêne, t. II, p. 133.
7 Revue d’Histoire Littéraire de la France, LXXI, n° 2, 1971, p. 217.
8 Monsieur d’Olive, II, 2 dans The Plays of George Chapman, éd. Thomas Marc Parrott, New York, Russel and Russel, 1961, t. I, p. 332. Ma traduction.
9 Cité par Pietro Toldo,"Etudes sur la poésie burlesque française de la Renaissance", Zeitschrift für romanische Philologie, XXV, 1901, p. 401 (voir en outre Goujet, Bibliothèque françoise, t. XVI, p. 221-222).
10 William Roberts,"Saint-Amant, Aytoun, and the Tobacco Sonnet", Modern Language Review, LIV, 1959, p. 499-506.
11 Jacob Balde, et d’autres écrivains néo-latins qui traitèrent du tabac, sont étudiés dans les articles de Ian D. McFarlane,"Tobacco – A Subject for Poetry", From Wolfram and Petrarch to Goethe and Grass. Studies in Literature in Honour of Leonard Forster, Baden-Baden, W. Körner, 1982, p. 427-441 et Dirk Sacré,"Quid Poetae Scriptoresve de tabaco senserint vel scripserint", Vox Latina, XXII, 1986, p. 540-545 et XXV, 1989, p. 88-90.
BABIN, François, Conférences ecclésiastiques du diocèse d’Angers, sur l’Eucharistie et le sacrifice de la messe, Paris, Gueffier, 1778.
CHAPMAN, George, The Plays, éd. Thomas Marc Parrott, New York, Russel and Russel, 1961.
DUCHEIN, Michel, Jacques Ier Stuart, Paris, Fayard, 2003.
McFARLANE, Ian D., "Tobacco – A Subject for Poetry", From Wolfram and Petrarch to Goethe and Grass. Studies in Literature in Honour of Leonard Forster, Baden-Baden, W. Körner, 1982, p. 427-441.
OLEARIUS Adam, Voyages très-curieux et très-renommez faits en Moscovie, Tartarie et Perse, par le sieur Adam Olearius, bibliothécaire du Duc de Holstein, et Mathematicien de sa cour, trad. Wicquefort, Amsterdam, Michel Charles Le Cene, 1727.
Dr. PEIGNEY, "Journal d’un médecin pendant la peste de Nimègue en 1637", La Chronique médicale, XXXVIII, n° 3, 1er mars 1931, p. 63-64.
PLATTER Thomas II, L’Europe de Thomas Platter : France, Angleterre, Pays-Bas (1599-1600), trad. Emmanuel Le Roy Ladurie et Francine-Dominique Lichtenhan, Paris, Fayard (= Le Siècle des Platter, t. III), 2006.
ROBERTS William, "Saint-Amant, Aytoun, and the Tobacco Sonnet", Modern Language Review, LIV, 1959, p. 499-506.
SACRÉ Dirk, "Quid Poetae Scriptoresve de tabaco senserint vel scripserint", Vox Latina, XXII, 1986, p. 540-545 et XXV, 1989, p. 88-90.
TOLDO Pietro, "Etudes sur la poésie burlesque française de la Renaissance", Zeitschrift für romanische Philologie, XXV, 1901, p. 385-410.